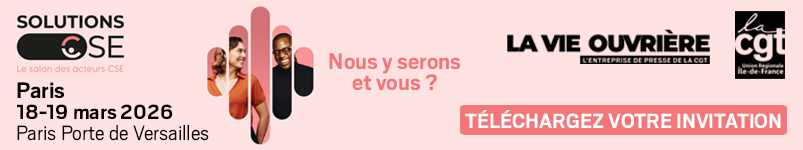Principe de défaveur


La loi, pourtant garante de l'intérêt général, doit se faire la plus discrète possible pour laisser la place au droit conventionnel. L'un des exemples le plus frappant du caractère supplétif de la loi est la possibilité désormais reconnue aux accords de branche de décider de la durée et du renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. Le niveau de la branche est donc prétendument renforcé pour faire dans le moins favorable que la loi !
Et l'articulation entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche est revue pour généraliser la primauté des accords d'entreprises dans la plupart des domaines, la convention de branche ne s'appliquant qu'à défaut. Elle ne peut interdire des dérogations en moins favorable que dans des domaines très limités. En outre, pour forcer la résistance des irréductibles Gaulois convaincus que ce nouveau droit conventionnel sera source de régression sociale, les ordonnances permettent aux employeurs de licencier les salariés récalcitrants du seul fait de leur refus d'accepter l'application d'un accord collectif sans le bénéfice du droit du licenciement pour cause économique. Le principe de faveur qui constituait jusqu'alors l'originalité du droit du travail français (une norme inférieure ne pouvant qu'améliorer une norme supérieure) a donc été transformé au fil des lois successives pour s'effacer presque totalement et devenir un principe de défaveur.