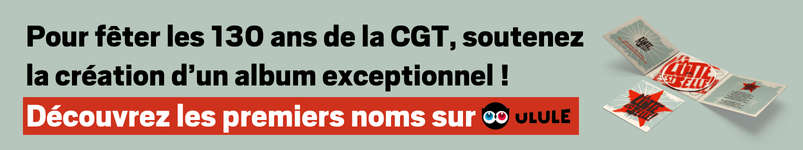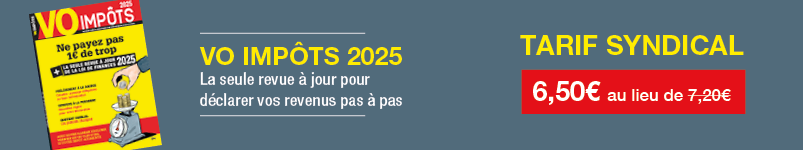La spécificité des syndicats catégoriels
Représentativité : la loi de 2008 a prévu, pour
les syndicats catégoriels, des modalités particulières d'appréciation de la représentativité les aidant
à se maintenir dans le paysage syndical. De nombreuses décisions de justice en découlent, interrogeant
la réalité de la spécificité de ces organisations.
La loi du 20 août 2008 a, on le sait, changé radicalement les règles de la représentativité. Celle-ci doit maintenant être prouvée, à l'aide de sept critères dont l'audience (Art. L.2121-1 du code du travail). Taxées d'opération de sauvetage par certains commentateurs, des règles distinctes ont été instaurées au profit des syndicats catégoriels. Mais la reconnaissance de la spécificité de ces syndicats donne lieu à débats doctrinaux et actions en justice. En quoi justement sont-ils spécifiques et l'existence d'un « privilège » (voir par ex. D. Martinon, « La représentativité des syndicats catégoriels », JCP La sem. jur., éd. soc. n° 22 p. 29) à leur égard est-elle justifiée ?
Une abondante jurisprudence permet d'identifier les syndicats catégoriels et donne des éclairages tant sur l'appréciation de leur représentativité que sur leur place dans la négociation collective.
Identification
des syndicats catégoriels
Les syndicats catégoriels sont ceux qui, en vertu de leurs statuts, ne peuvent présenter des candidats que dans des collèges électoraux déterminés. On trouve une illustration de ce principe dans un arrêt qui distingue la situation du syndicat national du personnel commercial navigant « qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux » de la situation des organisations syndicales catégorielles « dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés » (Cass. soc. 14 déc. 2011, n° 10-18699 P).
Il s'agit en premier lieu des syndicats qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels du personnel d'encadrement. La catégorie est fonction des responsabilités endossées (ou supposées l'être) par les salariés visés (à la suite de l'arrêt Pain « avantages catégoriels issus des accords collectifs », la Cour de cassation a rendu un arrêt moins rigide qui évoque « les spécificités de la situation de salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » : Cass. Soc. 8 juin 2011, n° 10-14725 P). Il faut inclure également les syndicats de journalistes et le syndicat du personnel navigant technique, c'est-à-dire des pilotes de ligne. La « catégorie » est ici liée à un métier auquel la loi reconnaît un régime de représentation spéciale.
Parmi les syndicats catégoriels, il en est qui sont affiliés à des confédérations intercatégorielles – par exemple l'Ugict-CGT ou le SNJ-CGT – d'autres à des confédérations catégorielles. Actuellement il n'en existe qu'une, la CFE-CGC. D'autres organisations, dites autonomes, ne sont rattachées à aucune confédération : le SNJ ou le syndicat des pilotes de lignes.
Mesure de la représentativité
1°) Règles distinctes
Selon la loi, est représentatif un syndicat qui répond à tous les critères de
l'article L. 2121-1 du code du travail et qui obtient au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des mem- bres titulaires du CE de la DUP ou, à défaut des DP. À côté de ces règles générales, la loi a introduit des règles applicables uniquement à certains syndicats catégoriels.
Les cadres, d'abord. L'article L. 2122-2 du code du travail réserve un privilège aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle, c'est-à-dire à la CFE-CGC : ils ne doivent obtenir le score de 10 % que dans les collèges dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats. C'est-à-dire, en général, les deuxième et troisième collèges. Franchir la barre des 10 %
et accéder ainsi à la représentativité leur est plus simple que pour tous les autres syndicats, y compris les syndicats catégoriels non affiliés à la CFE-CGC, qui doivent obtenir au moins 10 %
sur l'ensemble des collèges.
Deux autres syndicats catégoriels bénéficient de règles particulières. Selon l'article L. 7111-7 du code du travail, lorsque dans les entreprises de presse (Et, plus précisément, les entreprises de publications quotidiennes ou périodiques, les agences de presse et les entreprises de communication au public par voie électronique) un collège spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui obtient 10 % des voix dans ce seul collège est représentative. Il n'y a pas d'autres conditions à ces modalités d'appréciation de la représentativité que l'inscription, imposée par le protocole d'accord préélectoral, de tous les journalistes dans ce collège. Selon la Cour de cassation, cela interdit à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, mais n'empêche pas l'inscription d'autres salariés dans le collège « journalistes ». Autre facilité, la création d'un collège journalistes dans le protocole d'accord préélectoral ne requiert pas l'unanimité (Cass. soc. 2 mars 2011, n° 10-60157 P et Cass. Soc. 2 mars 2011, n° 09-60419 P, Dr. Ouv. 2011 p. 373, commentaire critique de Ph. Masson).
Par ailleurs, dans les entreprises de transport et de travail aériens, si un collège spécifique est créé pour le personnel navigant technique, le score de 10 % sera apprécié dans ce seul collège. Contrairement aux journalistes, la loi pose une condition à la création de ce collège : il doit concerner au moins vingt-cinq salariés (Art. L. 6524-3 et L. 6524-2 du code des transports).
Précision récente des juges à l'occasion d'un litige électoral né à Air France : le fait qu'un collège spécifique soit créé pour les pilotes de ligne n'est pas une raison pour que les suffrages exprimés dans ce collège soient soustraits de l'ensemble des suffrages servant de base au calcul de l'audience des syndicats intercatégoriels. Une décision justifiée au regard du fait qu'un syndicat intercatégoriel est censée, comme son nom l'indique, représenter toutes les catégories de salariés dans la négociation collective (Cass. soc. 12 avril 2012, n° 11-22408 P, JCP La sem. jur., éd. soc. 2012 p. 48, note L. Pécaud-Révolier. Aucune catégorie ne doit être « mise à l'écart de la détermination de la capacité des syndicats généralistes à représenter toute la communauté de travail dans l'entreprise »). Cet arrêt a une portée générale.
2°) Un syndicat catégoriel peut-il présenter des candidats dans tous les collèges ?
Les juges affirment que les statuts du syndicat déterminent les collèges dans lesquels il peut présenter des candidats. Les statuts peuvent l'autoriser à présenter des listes dans le premier collège. Comment alors décompter les voix qu'il a obtenues pour vérifier qu'il a franchi le seuil des 10 % ?
Le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion, affilié à la CFE-CGC, avait modifié ses statuts dix-huit jours avant la signature du protocole d'accord préélectoral. On lui reprochait d'avoir présenté aux élections des listes dans tous les collèges. Or, ses statuts visaient très largement « tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement de même que ceux qui aspirent à en faire partie en cours de formation (…) et les retraités des entreprises (…) dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution… ». La cour en a déduit que le syndicat pouvait présenter des candidats dans le collège employés (Cass. soc. 28 sept. 2011, n° 10-26693 P, voir F. Favennec-Héry, « Syndicats
catégoriels : de l'importance des statuts »,
Sem. soc. Lamy n° 01508 p. 4). Cet arrêt soulève une question de bon sens : si les syndicats catégoriels sont présents dans tous les collèges, en quoi se démarquent-ils des syndicats généralistes ? Par ailleurs, peut-on considérer, en l'espèce, que le critère légal de l'ancienneté (deux ans minimum) est rempli pour ce syndicat aux statuts fraîchement renouvelés ? Oui, si l'on admet que l'ancienneté est calculée à compter du dépôt des statuts d'origine.
La solution a quoi qu'il en soit un revers : les syndicats affiliés à la CFE-CGC perdent le privilège de l'article L. 2122-2 du code du travail. Ils doivent avoir obtenu 10 % sur l'ensemble des collèges. Ceci a été confirmé au sujet d'un syndicat affilié à la CFE-CGC qui avait présenté, au second tour seulement, des candidats dans le collège employés. Sa représentativité a été mesurée en fonction des résultats obtenus au 1er tour, mais tous collèges confondus (Cass. soc. 31 janv. 212, n° 11-60135 P. L'organisation en question regroupait « les cadres, cadres supérieurs ou administratifs,
les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités mais aussi, sous certaines conditions, les employés » !).
Rôle des syndicats catégoriels dans la négociation
Si la représentativité est un sésame pour l'accès à la table des négociations, la loi pose des exigences en matière de majorité pour la validité des accords susceptibles d'en résulter : les signataires doivent rassembler 30 % des suffrages (majorité d'engagement) et les opposants 50 %. Mais un syndicat catégoriel peut-il participer à toutes les négociations, y compris intercatégorielles ? Peut-il signer, avec d'autres syndicats, ou même seul, les accords intéressant tous les salariés ? L'hypothèse n'a pas été prévue par la loi de 2008.
L'article L. 2232-13 du code du travail plaide pour la participation d'un syndicat catégoriel à de telles négociations. Il prévoit que, dès lors que le syndicat affilié à une confédération catégorielle a établi sa représentativité au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter, il a le droit de négocier « toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ». Or un accord collectif intercatégoriel couvre par définition toutes les catégories, dont les cadres. Les juges ont confirmé ce point de vue.
Dans un arrêt important qui traite spécifiquement des syndicats affiliés à une confédération catégorielle mais qui a une portée générale, la chambre sociale affirme qu'un syndicat représentatif catégoriel peut avec des syndicats intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories du personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord (Cass. soc. 31 mai 2011, n° 10-14391 P.
H. Tissandier « L'avenir s'éclaire pour la CFE-CGC », RDT sept. 2011, p. 513. P. Adam, « Négociation collective intercatégorielle et CFE-CGC : la Cour de cassation ouvre grand
la porte », Sem. Soc. Lamy n° 1496 p. 4).
Pour négocier un accord intéressant tout le personnel, le seul fait qu'il ait établi sa représentativité suffit. En outre, il peut signer, avec d'autres, les accords. Mais dans ce cas, pour vérifier que les signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l'audience électorale du syndicat catégoriel doit être rapportée à l'ensemble de collèges électoraux. C'est-à-dire qu'elle doit être recalculée tous collèges confondus.
On peut imaginer qu'un syndicat catégoriel signe seul un accord collectif intercatégoriel. Mais il lui faudrait prouver une audience de 30 % dans le champ d'application de l'accord, et donc sur l'ensemble des votants.
Inversement, est-il possible pour un syndicat intercatégoriel de conclure un accord catégoriel ? L'article L. 2232-13 du code du travail l'autorise, à condition toutefois que le syndicat intercatégoriel ait établi sa représentativité dans le collège encadrement et que l'ensemble des signataires aient fait un score de 30 % dans ce collège précis.
en bref
Il n'y a pas rupture de l'égalité
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que la règle posée par l'article L. 2122-1 du code du travail ne constitue pas une inégalité de traitement entre les syndicats catégoriels car les syndicats affiliés à la CFE-CGC ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des syndicats généralistes (Cons. const. n° 2010-42, QPC du 7 oct. 2010). La Cour de cassation a quant à elle rendu des décisions dotées d'une argumentation plus précise où était mise en cause la conformité des règles propres aux syndicats catégoriels à certaines conventions internationales (Cass. soc. 2 mars 2011, n° 10-60214).
«